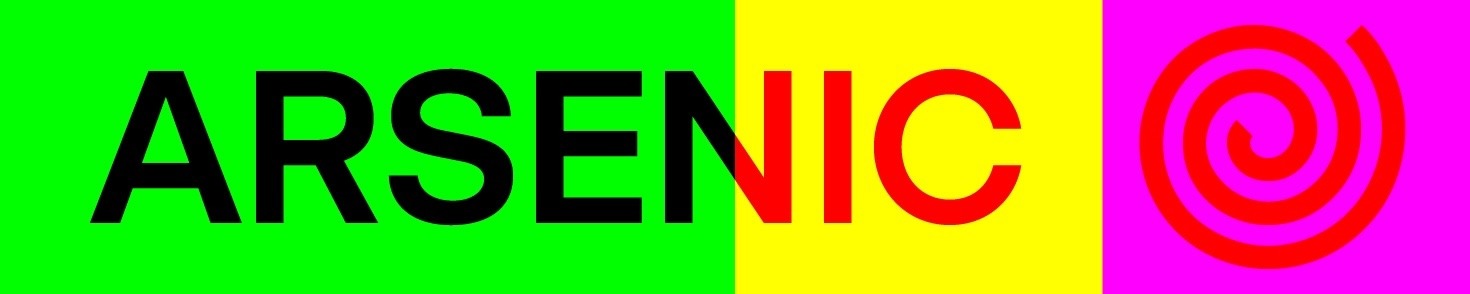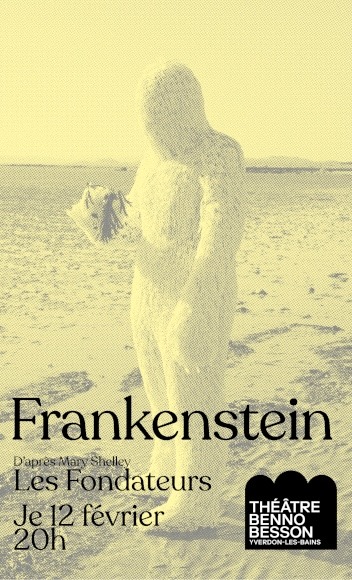Jeu de rôle à vie

La jeune femme déroule les clauses d’un contrat amoureux signé avec un homme alors inconnu et dont la rencontre s’est faite par petites annonces. Le protocole régissait tout : nombre de nuits passées ensemble, fréquence des rapports sexuels (quatre par mois), déclarations d’amour obligatoires.
L’idée ? Pousser à l’extrême la logique de rationalisation des sentiments, pour voir ce qui reste de l’amour quand on le débarrasse de son vernis romantique.
Lui, c’est Mike, trentenaire fan de SF et travaillant dans le garage de son père. Elle, c’est une performeuse, dont c’est la première fois en couple.
Derrière la précision juridique, affleurent les zones grises: attentes, malentendus, déséquilibres affectifs. Le contrat agit comme un révélateur, exposant ce que l’on préfère d’ordinaire laisser implicite dans les relations amoureuses.
Il s’agit donc d’ouvrir au public les archives d’un couple, jusque dans ses posts et reels sur Instagram. Libre à chacun d’interpréter, de reconnaître ou non quelque chose de ses propres schémas amoureux dans ces fragments.
En acceptant de rester dans cette zone de trouble - là où le cadre ne suffit plus à contenir l’affect - Jeanne Spaeter signe une œuvre qui politise l’intime sans jamais le refermer.
On peut sortir du spectacle avec une attention renouvelée à ce qui relève moins du destin amoureux que de structures que nous continuons, souvent malgré nous, à habiter.
Entretien.
Avant Amour sous Contrat, quelle était votre vision de l’amour et du couple?
Jeanne Spaeter: Avant la performance scénique que j’ai co-créée avec mon collaborateur artistique Nicolas Perrochet, ma vision du couple était déjà profondément critique. C’est précisément ce regard-là qui m’a conduite à engager ce projet.
Je ne considérais pas le couple comme une évidence naturelle, mais comme une construction sociale très normée, traversée par des règles implicites, presque contractuelles.
Ce qui m’intéressait, c’était de dénaturaliser cette forme de relation: rappeler qu’elle obéit à des attentes précises, à des obligations tacites, à des hiérarchies bien établies.
En particulier, je voulais interroger la place centrale qu’occupe la relation amoureuse - et plus largement familiale - dans notre échelle de valeurs.
D’autres liens, comme l’amitié, pourtant tout aussi structurants et essentiels, sont largement relégués au second plan.
En rédigeant un contrat amoureux extrêmement précis, était-ce une ironie critique ou une tentative d’optimisation réelle de l’amour?
Il y a évidemment une dimension ironique dans cette démarche. J’ai souvent présenté le projet comme une tentative de «maximisation» de la relation amoureuse, une manière d’en pousser l’ultra-rationalisation jusqu’à l’absurde.
Cette logique de rationalisation extrême fait pleinement partie du capitalisme contemporain et est au cœur des analyses d’Eva Illouz, dont je ne partage pas la position ambiguë sur le génocide à Gaza.
Cette sociologue parle des relations amoureuses en termes de contrats, d’échanges, de négociations. Ce sont des concepts scientifiques, mais moi, en tant qu’artiste, je les ai aussi lus comme des matériaux poétiques et performatifs.
Que sous-tendent le contrat et la performance?
Il y a l’idée qu’on pourrait devenir une version « optimisée » de soi-même, y compris dans l’amour. Et bien sûr, cette logique est profondément ambivalente.
D’un côté, elle promet de la clarté, de la maîtrise, une réduction de l’incertitude. De l’autre, elle révèle une violence sourde: celle d’un système qui transforme les relations humaines en projets à gérer, à évaluer, à rentabiliser.
Amour sous Contrat se situe exactement dans cette tension. Il ne s’agit ni d’adhérer naïvement à cette logique, ni de la dénoncer de l’extérieur, mais de l’habiter pleinement pour en faire apparaître les contradictions.
Vous organisez une cérémonie de mariage sur Zoom. Pourquoi avoir rejoué ce moment si codifié?
C’était sans doute le plus beau jour de ma vie. Et je le dis sans ironie. Ce 8 janvier 2021, Jeanne et Mike se disent oui devant une assemblée réunie sur Zoom: la famille, les ami·es, des proches, et Maître Emma Lidén, l’avocate qui encadre juridiquement la cérémonie.
Il y a un faire-part, une typographie, un rituel. Tout est là. Les codes du mariage sont respectés. Nous étions en pleine pandémie. Le Zoom s’est imposé presque naturellement, mais il est aussi devenu un révélateur.
Cette cérémonie à distance traduisait quelque chose de très juste sur notre époque. Un moment supposément intime, solennel, chargé symboliquement, mais médiatisé par un écran, cadré, fragmenté, observé.
Mike a dit ne pas se sentir aimé et quitte cette relation conjugale expérimentale et contractuelle au terme de dix mois et demi.
Lorsque Mike dit ne pas se sentir aimé, je l’entends moins comme l’échec d’un protocole que comme l’expression classique d’un déséquilibre affectif. Ce type de phrase traverse d’innombrables relations hétérosexuelles contemporaines.
Ce que le contrat fait? Il empêche de naturaliser cette souffrance. Et oblige à la regarder comme le résultat d’un cadre - et non comme une fatalité intime ou un défaut individuel.
Le projet ne propose donc aucun remède. Il dresse plutôt un constat: même lorsque tout est explicité, négocié, contractualisé, la douleur n’est pas éliminée. Elle circule autrement, mais elle circule quand même.
Et en ce sens, l’expérience rejoint très directement ce qu’analyse Eva Illouz : la souffrance amoureuse n’est pas un accident, c’est un symptôme structurel de nos manières contemporaines d’aimer.
Votre dispositif a parfois été lu comme une mise en situation asymétrique : vous fixez le cadre, Mike accepte. Comment avez-vous pensé cette question du pouvoir ?
La question du pouvoir est centrale, et elle était assumée dès le départ. Amour sous Contrat n’est pas un dispositif égalitaire au sens naïf du terme. Mais aucune relation ne l’est.
Ce que je voulais montrer, c’est précisément que les déséquilibres existent partout, y compris - et surtout - dans les couples dits «normaux». Au départ, il y a effectivement une asymétrie : c’est moi qui formule l’annonce, qui définis le cadre artistique, qui propose le contrat. Mike, lui, choisit d’entrer dans cette relation en connaissance de cause.
Mais inversement, je ne choisis pas Mike. Je pose des critères très généraux - être un homme, vivre à Berne ou aux alentours, parler français ou anglais, accepter de participer à la performance - et je m’engage avec la première personne qui dit oui.
D’un point de vue sociologique, il m’a autant choisie que je l’ai choisi.
Vous avez dit que vous et Mike vous êtes «mutuellement utilisés». En rendant cette instrumentalisation explicite par le contrat, l’avez-vous désamorcée ou amplifiée?
Je pense l’avoir désamorcée. Nous sommes entrés dans cette relation en connaissant parfaitement les termes, les attentes, le cadre. C’était une transparence radicale.
Dans une relation «classique», on s’engage souvent sans savoir précisément dans quoi, avec des attentes implicites et non-dites. Là, tout était sur la table. Cela a créé une forme de clarté et de négociation permanente qui, selon moi, est plus saine que les non-dits.
Cela n’a pas empêché les rapports de pouvoir ou les déséquilibres - ils existent dans tout couple - mais ils étaient au moins discutés.
Parlons de la matérialité de la performance : les objets exposés. Quel statut ont-ils pour vous aujourd’hui?
Ces objets ont eu plusieurs vies. D’abord, ils étaient des souvenirs triviaux, collectés parce que le contrat l’exigeait – le premier emballage de préservatifs, un ticket de caisse. Ensuite, ils sont devenus des pièces d’archive, des preuves documentaires.
Sur scène, disposés sur la table, ils prennent un statut muséal, presque sacré. Le public les regarde mais ne peut pas les toucher. Pour moi, ils oscillent toujours entre la froideur de la preuve et la chaleur du souvenir qu’ils évoquent.
Ils sont à la fois des reliques et des pièces à conviction d’une enquête sur l’amour.
Au plateau, vous êtes seule. La solitude est-elle devenue l’un des sujets d’Amour sous Contrat?
Le projet est né d’une réflexion sur la solitude et le célibat. J’étais irritée par la synonymie qu’on établit entre « célibataire » et « seul·e ». Je ne me sentais pas seule, j’étais entourée d’amitiés fortes.
Alors pourquoi cette quête romantique et cette pression sociale à être en couple ? Pourquoi ces relations ne « suffisaient-elles » pas socialement? La performance explore cela.
Et effectivement, sur scène, je suis seule face aux archives d’un couple disparu. Il y a la solitude qui précède l’expérience, celle qui suit la rupture, et peut-être aussi celle qui est au cœur de toute relation, ce fond d’incommunicabilité.
Poursuivrez-vous cette ligne dans vos prochains projets?
Oui. Bien sûr que cela m’oblige à réfléchir, à déplacer certaines choses, à affiner mes cadres. Mais je ne renonce pas à cette ligne de travail.
L’infiltration du quotidien, les effets réels sur les relations, les dilemmes éthiques : tout cela fait partie intégrante de ma pratique. Sinon, on ne fait que produire des formes inoffensives. Et ce n’est pas ce que je cherche.
Propos recueillis par Bertrand Tappolet
Amour sous Contrat
Les 13 et 14 février 2026 au Théâtre L'Échandole, Yverdon-les-Bains
Jeanne Spaeter, création, performance - Nicolas Perrochet, mise en scène - Magdalena Nadolska, dramaturgie - Caroline Bourrit, scénographie
Informations, réservations: https://echandole.ch/spectacles/amour-sous-contrat/